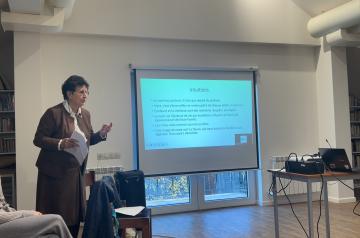Dans ce deuxième volet consacré au vingt-cinquième anniversaire de la fondation KASA en Arménie, sa présidente, Monique Bondolfi, évoque son parcours personnel et familial, l'histoire de ses origines aussi, et ces valeurs de cœur et d'optimisme qui ont guidé son action.
Propos recueillis par Olivier Merlet
Monique Bondolfi, vous nous avez précédemment raconté l'histoire de KASA, nous avons remonté le temps, jusqu’à ses origines, en retraçant ses 25 ans d'engagement. Un quart de siècle… Ce n'est pas rien dans une vie ! Parlez-nous de la vôtre.
Au départ, je suis enseignante de français et de philosophie au niveau du lycée, avec une maîtrise supplémentaire en théologie. Cette dernière m’a donné la possibilité à ma retraite d’intervenir comme enseignante à l’Atelier œcuménique de théologie de Genève, où des théologiens de différentes confessions chrétiennes partageaient leur vision du monde à partir de leurs traditions respectives. Peu enclins à une approche dogmatique, ils cherchaient à éclairer le vécu à partir de références bibliques, ecclésiologiques, éthiques ou spirituelles, dans un grand respect des différences : un lieu fraternel, proposant des pistes d’espérances, qui m’a beaucoup nourrie. Et où j’ai trouvé une écoute très attentive concernant l’Arménie.
Sensibilisée à la cause des femmes j’ai également assumé pendant 30 ans l’éditorial d'un journal de réflexion destinée aux femmes francophones de Suisse : "Vivre au présent, les femmes s'interrogent". Cette expérience m’a permis de découvrir des thématiques que je n’avais guère l’occasion d’aborder autrement, comme par exemple celle de la prostitution.
Et bien avant que la question environnementale ne s’impose sur les devants de la scène, je m’étais investie au niveau local dans la création d’un parti écologique, dont allait émerger en 1979 le premier député vert d’Europe.
Et donc, en 1995 vous décidez de partir en Arménie ?
Comme je l'ai déjà évoqué, nous organisons en 1995 une fête pour marquer nos 25 ans de mariage, à laquelle nous convions l’Atelier Vocal Komitas, lequel nous confie vouloir enregistrer un CD puis aller fêter ses 10 ans en Arménie. Mon mari chanteur s’y engage et c’est ainsi que de fil en aiguille nous sommes partis, avec, je tiens à le préciser, un groupe essentiellement non arménien. Et de fait, par la suite, contrairement à la plupart des associations qui agissent en Arménie, 90% des bienfaiteurs individuels de KASA sont non-Arméniens.
D’où viennent alors vos racines arméniennes ?
Ma famille est arménienne d'Égypte bien qu’originaire de Turquie. Mon grand-père, Puzant Masraff, vient de Samsoun, ma grand-mère, Christine Matossian, de Tokat. Arménien catholique Puzant part faire ses études au collège mekhitariste de San Lazzaro à Venise, puis son droit à Padoue. A son retour d’Europe il entre en contact avec la famille Matossian qui développe une entreprise de tabacs avec l'Égypte, où un tel commerce rencontre moins d’obstacles.
Mon grand-père épouse Christine, la cadette de cette famille - il en aura cinq enfants, dont mon père - et devient vingt ans durant l'un des directeurs généraux de cette manufacture de tabacs parmi les plus importantes au Moyen-Orient.
Après la première guerre mondiale il envoie ses enfants faire leurs études à Paris et à l'occasion d'un voyage pour aller les voir, il découvre en Suisse la petite ville d’Yverdon, avec des bains sulfureux et une eau minérale non exploitée. Inspiré par les stations thermales en vogue à cette époque, mon grand-père voit là un grand potentiel à exploiter et décide de quitter l’Égypte. Il achète à Yverdon une très belle maison du XVIIIe et développe l'exploitation des bains sulfureux. Il met en bouteille l’eau minérale, à laquelle, sur la suggestion d’un évêque arménien de ses amis, il donne le nom d’Arkina, ancienne résidence d’été du catholicos au Xème siècle.
Mon grand-père meurt en 1927. Bien que très jeune, mon père reprend toute l'affaire. C'est la crise des années 30, rien n'est facile, le grand immeuble des bains devient un immeuble locatif, les bains restent ouverts au seul niveau local. Mais l’Arkina se développe.
Début 1939 mon père part chercher une épouse arménienne en Égypte, et je nais fin 1939 en Suisse. J’y ai passé toute ma vie, encore qu’au début dans un environnement resté très marqué par l’Orient. Élevée à la maison puis dans un pensionnat international, ce n’est qu’à l’âge adulte que j’ai vraiment découvert la Suisse et ses habitants. J’y ai tracé mon sillon et rencontré mon mari en mai 1968 à l’université de Fribourg, alors que j’avais décidé de reprendre en parallèle à mon travail des études de philosophie : à chacun son mai 68 ! Une route d'enseignante de français et de philo dans le canton de Vaud, au collège, à l'école normale puis au lycée., tout en élevant quatre enfants et en nous réjouissant de nos huit petits-enfants.
Vous évoquez très souvent Dario, votre mari, lorsque l'on vous voit il n'est jamais très loin, quelle est son implication dans KASA ?
Elle est essentielle. C'est lui qui gère toutes les finances, étudie tous les budgets, les repense, les réarticule. Mais surtout on partage tout en termes de réflexion, tout en exerçant des charismes différents. « Dario et Monique, ça ne fait pas deux, ça fait trois, parce que des deux jaillit toujours un troisième terme » disait de nous une amie. Le chiffre trois permet de dépasser les oppositions et les clivages pour favoriser une approche originale...
Dario a repris la gestion de tous les chantiers après le décès accidentel en 2005 de notre ami entrepreneur Léonardo Gmür. Et lorsque l'association a pris de l'envergure, Il a accepté d’en gérer aussi les finances. Aujourd'hui, nous avons un comptable arménien très capable, de sorte que notre rôle est essentiellement de vérifier que tout marche bien. Mais la comptabilité de KASA demeure extrêmement complexe, vu le nombre de projets, et le fait qu’il faut chaque fois trouver des moyens de couvrir aussi les frais administratifs, ce que tous les donateurs ne sont pas disposés à faire.
La gestion, les affaires, c'était son métier d'origine ?
Pas du tout. Il est enseignant d’allemand et italien. Au reste, Dario s'est aussi beaucoup investi au niveau ecclésial en œuvrant au rétablissement du diaconat permanent en Suisse. Un ministère très ancien, que le concile Vatican II a décidé de restaurer pour favoriser une église plus proche du peuple, tout en laissant sa concrétisation locale à l'appréciation de chaque pays. Un ministère de service sur le terrain pour apporter une parole d’espérance et accompagner concrètement des gens dans les moments clés de leur vie. En particulier Dario, membre du Comité du Centre international du diaconat, a été secrétaire de la première rencontre internationale des diacres européens à Turin en 1977. Il a été ordonné diacre en 1996 et depuis sa retraite il s’implique surtout au sein de KASA pour y transmettre des valeurs ainsi que dans sa paroisse - baptêmes, mariages, funérailles -.
Vous évoquez la théologie que vous avez étudiée, le diaconat de Dario, l'œcuménisme, la foi, la religion… KASA est pourtant une organisation laïque ?
KASA n'a absolument aucune étiquette confessionnelle et elle y tient. Elle est née avec des protestants, des catholiques, des apostoliques et des gens sans confession. Néanmoins je pense que les valeurs que nous défendons sont des valeurs évangéliques, c'est-à-dire des valeurs de bien commun et d'ouverture à autrui.
Des valeurs universelles ?
Absolument. Ce que je préconise et appelle la troisième voie. En ce sens, peut-être, vous pouvez voir ces valeurs comme pétries d'Évangile. Je partirais d’une analyse sociologique plutôt que théologique. Nous arrivons en 1997 dans un pays postcommuniste, où le collectivisme a laissé des traces très fortes. Aujourd'hui encore, à Gumri, on interpelle l’équipe en utilisant le terme de "dzhoghov (ժողով)", "l'assemblée", le groupe. Le collectif reste central. Mais il se heurte, après l'effondrement de l'Union soviétique, à son contraire, l’individualisme. Lequel se traduit par une fascination pour la société industrielle et de consommation, avec le triomphe du libéralisme sauvage. : que les plus futés l'emportent, au mépris de la majorité, laissée pour compte. En créant KASA, nous avons voulu garder le meilleur du communisme, le sens du bien commun, et le meilleur de l'économie libérale, à savoir le sens des responsabilités qui incite à se prendre en main au lieu de tout attendre de l’État. Une intuition que j’ai pu étayer en me référant au personnalisme.
Qu'est-ce que le personnalisme ?
C'est un courant français né autour d'Emmanuel Mounier et de la revue Esprit. Dans les années 30, Emmanuel Mounier se trouve face au même dilemme que celui que l'on connaît ici, avec d'un côté la fascination d'André Gide et d'autres pour l'URSS, et de l'autre, une économie libérale extrêmement agressive. Dans ce contexte contrasté Mounier, propose de se recentrer autour de la personne, une option que nous avons adoptée dans notre Charte.
Commençons par reconnaître la personne au niveau de tous ses besoins. Ce n'est pas une sinécure : en Arménie, on accorde peu d'importance aux exigences physiques et au sport. De même les attentes affectives ne sont tolérées qu’en famille ou avec des intimes et les hommes ne sont guère autorisés à exprimer publiquement leurs sentiments. Quant à l’intellect, il est trop souvent déconnecté de la réalité : on connaît la théorie, mais on ne l’applique pas, faute d’occasions d’apprentissage sur le terrain. Il y a donc toute une éducation à faire. Celle d’un JE complet et ouvert à l'autre, au TU, à travers une éducation au dialogue et à la reconnaissance de l’altérité. « Toi et moi tous seuls on ne peut rien, mais toi et moi ensemble on peut beaucoup », résumait une de nos collaboratrices. Il s’agit de prendre conscience que dans sa relation à autrui, on a des droits et des devoirs - c’est le niveau du IL, impersonnel mais nécessaire - et que cette relation bien comprise doit déboucher sur un NOUS soucieux du bien commun, sans pour autant lui sacrifier l’individu.
Les premières années la plupart des femmes que nous rencontrions nous disaient : « Nous, on n’est que des fonctions, on n'existe pas, on n'a pas de personnalité ». De tels propos nous ont beaucoup interpellés. Et nous ont incités à donner un visage à ces femmes pour leur rendre leur identité, une identité large, au-delà de la seule structure qui tient l'Arménie, celle de la famille et du clan. Comment les ouvrir à la société civile ? D'où le fait que nous avons monté de nombreux clubs où nos équipes encouragent le civisme, la responsabilité des jeunes et l’attention aux besoins de leur communauté. Nos collaborateurs ont conçu énormément de projets à travers lesquels, progressivement, après avoir aidé nos bénéficiaires à prendre confiance en eux, ils les amènent à réaliser les besoins de leur environnement.
Alors, derrière cette attitude de confiance on peut certes repérer l’esprit de l'Évangile. Nous vivons dans un monde extrêmement binaire : les Américains contre les Russes, les Russes contre les Ukrainiens. L’Évangile nous invite à une approche dynamique et audacieuse, au-delà des lois et des prescriptions auxquelles on a voulu malencontreusement et trop souvent le réduire et qui, parfois, servent de repoussoir. Il écarte les frontières, invite à changer son regard pour faire confiance en la vie en repérant la petite graine qui pousse ! C'est exactement ce que KASA tente de faire : sortir d'une vision statique et figée. Amener ailleurs pour repérer le potentiel de chacun, au-delà de ses failles. Pour ouvrir à l'interculturel, à l'intergénérationnel, accepter les différences et protéger les minorités.
À propos du chemin parcouru par KASA, vous évoquez des émotions que vous qualifiez d'indignation face à la misère, les spoliations et les coups tordus. Au regard de la situation politique et géopolitique qui éreinte aujourd'hui l'Arménie, cette remarque sonne très actuelle. Quel sens donnez-vous à ces propos ?
Ils concernent aussi bien la situation interne qu’externe.
Une nuit, nous avons entendu des hurlements, l'impression qu'on égorgeait quelqu'un : un homme battait sa femme à mort. Et cette misère morale continue encore aujourd'hui. Tout comme celle de ces gamins que l'on voyait encore en 2005 à Gumri, assis et atones et aphones sur un trottoir sans le moindre jouet et pour lesquels nous avons voulu créer un espace de jeux convivial. Et celle de ces femmes abandonnées par leur mari, tentant d’exister et de tenir le coup entre des parents nostalgiques de la période soviétique et des enfants qui ne pensent qu'à jouer à la Gameboy.
La bêtise, oui face à de honteuses spoliations. Dans un village du nord où nous nous étions beaucoup investis les paysans étaient très fiers de la coopérative qu’ils avaient réussi à monter en trouvant des engrais à bon prix. Mais leur fournisseur a été acculé à la faillite par un marchand peu scrupuleux, de sorte que les prix ont pris l’ascenseur : il devenait trop coûteux de cultiver sa terre, du coup beaucoup ont tout abandonné, laissant le sol en friche.
Au demeurant mon indignation porte éminemment sur la honteuse solitude dans laquelle est plongée l’Arménie au niveau international. Ici je tente de ne pas perdre courage en m’impliquant là où je pense être quelque peu utile. A savoir via un travail d’information avec notre comité suisse à travers des articles, la participation à des manifestations, et en gardant le souci de travailler avec tous ceux qui sont prêts à tirer à la même corde.
Mais au final une indignation constructive n’est-elle pas indispensable pour ne pas se laver lâchement les mains et cultiver ce que d’aucuns appelleraient un optimisme tragique, entre le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme du cœur ?