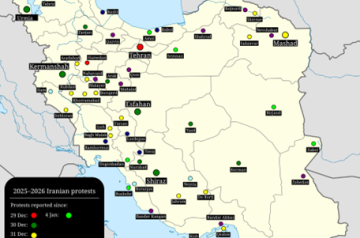Les calendriers diffèrent entre la France et l’Arménie, notamment à la mi-octobre, qui marque le « Nouvel An de la Tech » côté arménien. Cet événement prend la forme d'un salon de trois jours, Digitec, qui rassemble plusieurs centaines d’exposants, des grandes entreprises aux start-up, et qui propose des conférences avec des experts locaux et internationaux. Les domaines représentés sont l’EdTech, les transports, l’information, l’IA ou les FinTech. C’est l’UATE (Union des entreprises de technologies avancées d’Arménie) qui, depuis 20 ans, cultive l’écosystème tech du pays. Aujourd’hui, l’Arménie est à la pointe du Caucase dans ce domaine. Le secteur a atteint un momentum, et pour l’exploiter effectivement, ses représentants se tournent vers l’État afin de couronner leurs efforts d’une stratégie leur permettant d’être facilement identifiés à l’étranger sous une marque nationale, à l’image de La French Tech en France ou de la société numérique avec E-Estonia.
Par Camille Ramencourt
Un écosystème né sur le terrain
Il est difficile de croire que l’UATE a eu du mal à convaincre les politiques d’investir dans la technologie il y a 20 ans, alors qu'elle représente aujourd'hui l'un des principaux moteurs de croissance et un facteur d'attractivité crucial pour les investissements dans le pays. C’est pourtant ce que Sargis Karapetyan, directeur de l’UATE, explique. L’écosystème s’est développé de manière ascendante, grâce à d'importants investissements du secteur lui-même et à l'apport extérieur des Arméniens de la diaspora.
La part croissante du PIB que représente la technologie (de 4,5 % en 2022 à 7 % en 2025) n’est pas tombée du ciel : elle est le résultat d’un travail à long terme, souligne Gohar Abajyan, directrice d’Enterprise Armenia, une structure qui attire les investissements étrangers en Arménie. Tumo, fondé par un Arménien de la Silicon Valley, et Armath, fondé par l’UATE, en sont l’incarnation : créés il y a bientôt 15 ans pour former les jeunes aux nouvelles technologies, ces deux organismes récoltent aujourd’hui les fruits de leur travail en formant les ingénieurs qui font briller la tech arménienne à l’international.
Depuis, le secteur public leur a emboîté le pas : des cours d’IA générative sont par exemple proposés à l’école, et l’État ainsi que la municipalité d’Erevan sponsorisent Digitec. Il s'agissait de faire ses preuves avant de gagner la confiance des institutions. Aujourd’hui, avec 1 200 entreprises, 130 start-up et 2,6 milliards de dollars d’exportations annuelles, le secteur de la technologie arménien se porte bien, parfois même mieux que des pays dont les démarches de « branding » sont plus anciennes. L’Estonie, par exemple, qui est connue comme une nation numérique et travaille en ce sens depuis 2001, n’a « que » 10 start-up pour 1,3 million d’habitants. Gohar Abajyan se félicite que l’Arménie ait construit l’écosystème technologique le plus avancé de la région, mais « la tech ne se vend plus par elle-même, il faut un narratif », et c’est là qu’entre en jeu l’image de marque.
À la recherche d'une identité pour se vendre à l'étranger
Comme la France a son coq, l’Arménie peut se forger une image de marque grâce à son histoire. L'événement Digitec lui-même propose des pistes : celles du peuple inventeur, des générations imprégnées de culture scientifique depuis des siècles, et de la diaspora. Il se présente comme le « Nouvel An de la Tech » pour souligner l’aspect immanquable qu’il doit revêtir pour les acteurs de la tech de la diaspora : « Une fois par an, sans faute, le réseau mondial des Techarméniens revient à la maison », peut-on lire sur leur site, réseau sur lequel « le soleil ne se couche jamais ».
La diaspora représente un immense avantage pour l’Arménie. L’UATE sait mobiliser ces ambassadeurs officieux pour implanter en Arménie leurs initiatives, leurs savoirs et leurs investissements. Ainsi, en plus de la culture tech internationale qu’ils apportent dans le pays, ces investissements importants sont un gage de confiance pour d’autres acteurs sans lien de parenté avec l’Arménie.
Mais besoin est maintenant de “combler l’écart entre le terrain et le marché global” exprime Sargis Karapetyan et de s’unir derrière une marque unique représentant le secteur à l’étranger. Pour lui, la valeur de l’image de marque est celle de l'absence de coût d’acquisition de nouveaux clients, d’une clientèle entrante (inbound customers), qui, connaissant ou découvrant la marque par eux-même, en sont convaincus. Des efforts avaient déjà été entrepris en ce sens il y a quelques années avec “Why Armenia” mais la marque n’a pas pris. “L’enjeu est que tous les acteurs de la tech utilisent la marque” explique le directeur de l’UATE. L’image de marque renforcerait l’efficacité des ambassadeurs au sein de la diaspora, associerait privé et public dans une démarche de long-terme, en structurant le secteur intérieurement, par le sens de la communauté, et extérieurement, en choisissant l’image projetée à l’international. Or, le sens de la communauté est intrinsèque à l’Arménie, au contraire de la France, mentionne Catherine Jurovsky de Business France, ou il a dû être cultivé. Désormais le mouvement de La French Tech a son emblème, et rassemble entreprises françaises, francophones, francophiles à travers le monde autour de sa particularité : la langue et la culture.
Les représentantes de Digital Nation (Estonie) et de La French Tech ont bien souligné que le succès de leur image de marque n’était pas arrivé par accident. Il y avait une volonté nationale, des équipes dédiées, beaucoup de travail et le fait de savoir capitaliser sur ses spécificités et sur les moments où l’attention internationale était portée sur le pays. L’Estonie a ainsi profité de sa victoire à l’Eurovision 2001 pour définir internationalement son image de marque, la première société digitale. Pour Catherine Jurovsky, la techarménienne est un diamant brut : tous les éléments sont présents, mais il faut désormais la polir pour que le monde la remarque à sa juste valeur, en déterminant ce qui la rend unique.